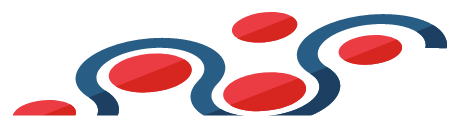Formation de conseiller en prévention ne répond plus aux besoins du service
Lors de la formation de conseiller en prévention un participant disait à la fin d’une session consacrée au comportement et leadership de sécurité : “C’était de loin le module le plus intéressant de tout le programme de formation, car il va au cœur du défi que nous devons relever chaque jour en tant que conseiller en prévention. Cette session ne doit pas seulement être donnée au début de la formation, le thème du comportement de sécurité doit être abordé au moins durant la majorité de toute la formation…”.
La réflexion est on ne peut plus judicieuse.
La sécurité au travail est une priorité partout.
Nous ne pouvons pas l’ignorer : depuis plusieurs décennies, la sécurité au travail est partout devenue une priorité. Et à juste titre.
Depuis sa création, le domaine de la sécurité au travail a continué d’évoluer considérablement. Au tout début, l’ingénieur de sécurité était la fonction de sécurité la plus importante.
Au fur et à mesure que la technologie évolue, l’attention s’est tournée vers l’aspect organisationnel de la sécurité au travail au lieu de l’aspect technique. Par conséquent, la mise en œuvre de toutes sortes de systèmes de sécurité est devenue très importante. La sécurité au travail est devenue un domaine de plus en plus administratif, dans lequel la gestion et la mise à jour du “système” prédominent.
En attendant, il est clair pour tout le monde dans l’organisation que l’impact des systèmes de sécurité sur la perception globale de la sécurité se heurte à ses propres limites.
L’attention portée à la culture de la sécurité s’accroît rapidement.
La culture de sécurité a rapidement gagné en popularité. D’une part, ce concept reste vague et parfois insaisissable ; d’autre part, il est sans doute l’aspect qui a le plus d’impact sur vos résultats en matière de sécurité. Après tout, il s’agit de la façon dont toute l’organisation traite la sécurité au travail.
Pour changer et/ou développer une culture de sécurité il faut pouvoir influencer le comportement de la collectivité. Influencer le comportement individuel n’estdéjà pas facile en soi. Influencer celui d’un groupe l’est d’autant plus. Influencer le comportement de toute une organisation, qui a eu le temps de se développer pendant des dizaines d’années, est dès lors un défi d’un tout autre ordre.
Les théories comportementales classiques sont dépassées.
Il existe encore des cadres, des dirigeants et des responsables de services d’appui qui – consciemment ou inconsciemment – supposent que le comportement (de sécurité) est le résultat d’un processus de réflexion rationnel et analytique. Un processus que l’on arrive à orienter dans la bonne direction au moyen de législation, de procédures, d’instructions et/ou d’autres types d’information au sujet de la sécurité. Cette vision des choses est désormais dépassée.
La science comportementale n’a pas cessé d’évoluer. D’importants scientifiques tels que Kahneman, Thaler, Ajzen et Cialdini ont changé grâce à leurs recherches notre vision sur des aspects tels que le comportement des consommateurs, la sécurité routière ou le comportement de sécurité sur le lieu de travail.
Tous les spécialistes en études comportementales sont désormais d’accord que le comportement humain résulte en grande partie de l’inconscient et de l’intuition qui n’ont guère à voir avec des considérations rationnelles.
Un défi d’un ordre supérieur exige des compétences supérieures.
Qu’il n’y ait pas de malentendu : pour développer, modifier et/ou influencer les comportements de sécurité, il ne suffit pas de simplement connaître la législation pertinente. Tout comme la connaissance des risques électriques et/ou chimiques ou la gestion des systèmes de sécurité applicables dans votre organisation non plus.
D’autres compétences sont désormais nécessaires: des compétences qui proviennent du monde de la psychologie, de la sociologie, de la biologie et de l’anthropologie. Mais il est aussi important de renforcer ses compétences et qualités personnelles, comme l’intelligence relationnelle, la motivation personnelle et un leadership authentique.
Êtes-vous prêt à faire face à ce nouveau défi?
Ne nous voilons pas la face: les formations existantes pour les spécialistes de la sécuriténe traitent surtout et encore que la législation, la sécurité technique, la sécurité organisationnelle et les disciplines connexes. Le législateur accuse un gros retard.
Les responsabilités légales du personnel d’encadrement n’apportent pas non plus de réponse adéquate à ces défis comportementaux, tout comme la formation obligatoire que doivent proposer les organisations à leurs cadres.
On ne peut toutefois que conclure: il faut d’urgence une nouvelle formation qui relève le défi de l’évolution de la fonction de conseiller en prévention et du personnel d’encadrement : du technicien au psychologue.